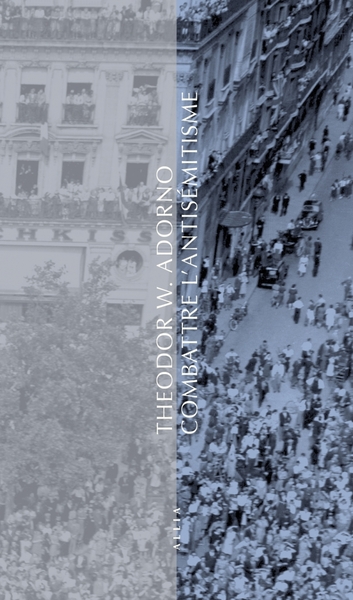
À l’automne 1962, Theodor W. Adorno est invité à la Première Conférence des Pédagogues par le Conseil de Coordination des Sociétés pour la Coopération entre Chrétiens et Juifs, une institution fondée en 1949. Devant un auditoire d’enseignants et de pédagogues, il donne une conférence consacrée à la lutte contre l’antisémitisme, dans la droite ligne de ses grands ouvrages La Dialectique de la raison (1944) ou Études sur la personnalité autoritaire (1950).
Dans le contexte de l’après-guerre, il constate la persistance des préjugés antisémites dans la société allemande. Par un réflexe de déculpabilisation et d’autodéfense collective, l’antisémitisme perdure insidieusement, entre rumeurs et insinuations. Dans une époque façonnée par les médias de masse, la publicité et la propagande, « on trouve aussi, au cœur du préjugé antisémite, la même tendance consistant à manipuler et à mettre au service d’intérêts particuliers en tous genres l’inconscient qui couve, au lieu d’en mettre à jour les processus. » Comment lutter à armes égales ?
Dès l’enfance, l’école offre un terreau favorable aux phénomènes de groupe et d’exclusion qui révèlent les mentalités autoritaires. Le rôle de la pédagogie sera crucial, pour prévenir le plus tôt possible le développement d’un caractère antisémite. Adorno prône également une loyauté inébranlable envers la raison, la vérité, la réalité historique et politique : « Reculer n’est pas une bonne option. »
Philosophe, sociologue et musicologue allemand, Theodor W. Adorno (1903-1969) suit des études de philosophie. Après avoir soutenu sa thèse sur Husserl en 1923, il devient l’élève du musicien Alban Berg. En 1938, il rejoint Max Horkheimer à l’Institut de recherche sociale de New York, avec qui il écrira Dialectique de la raison. Après de nombreuses publications sur la musique et la consommation culturelle à l’ère industrielle, il laisse inachevée sa Théorie esthétique, parue à titre posthume.
